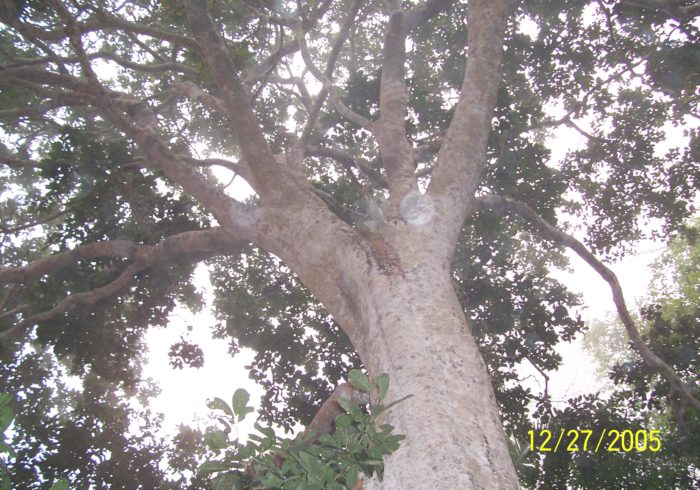Thèse de Doctorat:
KOURA Windékpè Tatiana (2015). Analyse des modes et techniques d’utilisation des résidus des huileries de palme et leur application pour la production de trois legumes traditionnels (Lycopersicon esculentum, Amaranthus cruentus, Corchorus olitorius) dans le Sud Bénin. Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles/ Faculté des Sciences Agronomiques/ Université d’Abomey Calavi, République du Bénin, 252p.
Directeur de these: Prof. Dr. Ir. SINSIN A. Brice.
Résumé: Du fait de la redynamisation de la filière palmier à huile dans le Sud-Bénin, certaines huileries sont confrontées à des problèmes de gestion de leurs déchets. Pourtant, différentes utilisations de des déchets d’huilerie existent. Pour apprécier la gestion faite de ces déchets, les systèmes de production des déchets ont été d’une part déterminés par une classification numérique en tenant compte des facteurs de production d’huile de palme et des quantités de déchets produits, et d’autre part caractérisés à partir d’une analyse en composante principale. Une enquête semi structurée a été effectuée auprès de 335 huileries. Les méthodes traditionnelles (T), améliorées (A), modernes (M) et mini industrialisées (MI) ont été les quatre méthodes d’extraction (ME) identifiées. La quantité de déchets générée par chaque huilerie a été déterminée en évaluant celle générée par 7 huileries T, 4 huileries A, 4 huileries M et 9 huileries MI, choisies de façon aléatoire. Petites avec, moyennes, grandes et très grandes ont été les quatre classes de systèmes de production de déchets identifiées. Ces quatre classes de systèmes ont produit en moyenne par an respectivement concernant -i- des pédoncules et rafles 12,4 ± 22 t, 31,3 ± 52,8 t, 132,7 ± 59,1 t et, 800,7 ± 418,1 t, -ii- des Fibres 5,6 ± 10,3 t, 13,6 ± 23,1 t, 135,2 ± 95,2 t et 637 ± 312,6 t, et -iii- des boues 15,1 ± 23,7 t, 40,9 ±28,0 t, 233,4 ±172,1 t et 572,6 ± 90,3 t. Les quatre classes de systèmes de production de déchets se discriminaient par la nature et la superficie des plantations, la capacité financière des propriétaires des huileries à engager des manœuvres et les quantités de déchets produits. L’utilisation de toutes les quantités de déchets sous forme de pédoncules, de rafles et de fibres produits ne dépendaient pas des quantités produites. Ainsi, la relation existant entre l’amélioration de la méthode d’extraction (ME) et la gestion faite de ces déchets a été analysée. L’effet de la ME, du type de déchet et de leur interaction sur les indices calculés comme l’importance d’un usage, la valeur d’usage, le pourcentage d’utilisateurs, la valeur commerciale, le taux de rejet ont été évalués à l’aide de l’analyse log linéaire. Les degrés de fidélité des usages ont été calculés. Les résultats ont montré que quelle que soit la ME, le degré de fidélité des usages ne variait pas de façon significative (p>0,05). Quelle que soit la ME, le surplus de déchets était éliminé soit par le rejet dans la nature ou par la vente. Ces options s’accentuent lorsque la ME s’améliore. Ensuite, les indices ethnobotaniques ont été utilisés pour appréhender l’importance et la valeur d’usage des déchets d’huileries de palme selon les zones de production de palmier à huile. L’analyse factorielle a été utilisée pour montrer le lien entre les zones de production du palmier à huile et les usages faits de ces déchets. Les résultats ont montré que les producteurs n’accordaient aucune importance à la boue. Les huileries où toute la quantité de pédoncules et de rafles produites était utilisée ont été celles pour qui ces déchets étaient importants et qui les utilisaient pour un seul usage. Les départements du Plateau, du Couffo et du Mono ont été les zones où les déchets d’huilerie contribuaient plus à la pollution environnementale. Afin de trouver des solutions durables immédiates aux huileries confrontées à ces problèmes de gestion de déchets, l’étude propose le co-compostage de ces déchets et l’utilisation du compost ainsi obtenu dans la production de légumes. L’analyse de la durabilité des pratiques agricoles des producteurs en relation avec leur connaissance a révélé que l’utilisation des rafles, des pédoncules et des fibres dépend de la connaissance des producteurs. Ces déchets ont été répandus directement par application locale (76,5%) ou par mulching (33,3%) dans les plantations ou indirectement après leur compostage. Le compostage se faisait soit en tas, soit associé à l’élevage porcin ou soit en fosse. Le compostage était inconnu de 67,5% des producteurs et la différence entre ceux qui le connaissaient et le pratiquaient et ceux qui ne le pratiquaient pas tout en connaissant cette option a résidé dans les connaissances de ces derniers sur les avantages du compostage. La composition physico chimique de ces déchets a été évaluée à l’aide d’un chromatographe ionique et a révélé que ces déchets étaient relativement riches en éléments nutritifs pour la plante sauf en phosphore. Le co-compostage des rafles, des pédoncules et des fibres a été expérimenté dans 18 bacs installés dans un dispositif de split plot non répété avec le mode de compostage [Sous abris (SA) et à l’air libre (AL)] comme facteur principal et le type de ferment [sans ferment (SF), fientes de volaille (FV) et déjections bovines (DB)] comme facteur secondaire. Les résultats ont montré que la décomposition de ces déchets et la qualité des composts obtenus variait significativement (p<0.05) selon le mode de compostage et le type de ferment utilisés. Le plus faible rapport Carbon/Azote (C/N) de 18,38 a été obtenu au niveau des composts où les FV ont été utilisées et le compostage réalisé SA. L’utilisation des FV a améliorée la qualité des composts en phosphore. Toutefois, l’analyse des lixiviats a révélé une forte perte en azote totale (88,3 ± 12,6 à 146,2 ± 16,4 mg/L), potassium (37,2 ± 0,8 à 53,3 ± 1,2 mg/L) et phosphore (107,9 ± 23,7 à 187,4 ± 65,8 mg/L). Les fortes teneurs en chlorure (1301,3 ± 195,8 à 1656,7±147,8 mg/L) et la demande biologique en oxygène (3.499,0 ± 425,8 à 6.370,7 ± 1.031,7 mg/L) ont montré la nécessité d’éviter de réaliser le compostage en tas directement sur le sol. L’efficacité agronomique des composts ainsi obtenus dans la production de tomate (Lycopersicon esculentum), de la corète potagère (Corchorus olitorius) et de légume feuille amarante (Amaranthus hybridus) a été évaluée à travers un dispositif en split-split plot avec le mode de compostage comme facteur principal et les types de ferment et doses d’application des composts (0 t/ha, 5 t/ha, 10 t/ha et 20 t/ha) comme facteurs secondaires, soit 24 traitements et 4 répétitions par légume. Le compost à base des FV réalisé SA aaugmenté la croissance et le rendement (19,2t/ha) de l’amarante comparé aux autres types de composts. Par contre, dans le cas de la corète potagère, les composts à base de ces déchets et des DB réalisés AL étaient plus recommandés. L’application des composts a accru le rendement de la corète potagère et de la tomate à partir de 10 t/ha.
Mots clés: déchets des huileries de palme, gestion des déchets, méthode d’extraction, type de ferment, mode de compostage, production de légumes