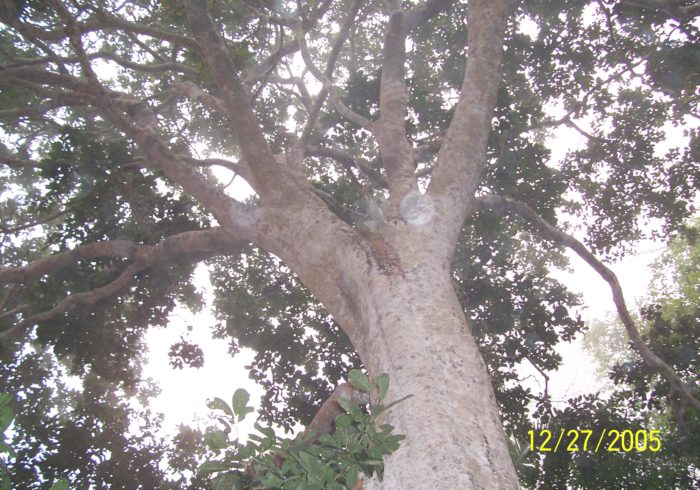Thèse de Doctorat:
Thierry Houehanou (2012). Évaluation de l’efficacité écologique de la réserve de biosphère de Pendjari dans la conservation de la biodiversité au Bénin (Afrique de l’Ouest). UNIVERSITE OF ABOMEY-CALAVI, Benin. 179 pages.
Directeur de thèse : Prof. Dr. Ir. Brice A. SINSIN.
RESUME: Les zones protégées étant souvent considérées comme le meilleur moyen de conserver la biodiversité, la présente étude a évalué l’efficacité écologique de la réserve de biosphère de Pendjari dans la conservation de certaines cibles de biodiversité. Au chapitre 1 (introduction générale), l’arrière-plan de l’étude, les objectifs, certains concepts théoriques et la structure de la thèse sont présentés, tandis que le chapitre 2 présente le domaine d’étude. Les connaissances écologiques traditionnelles liées à ces espèces ont été documentées. Ces espèces sont Afzelia africana Sm., Pterocarpus erinaceus Poir. et Khaya senegalensis (Desv.) A. Juss, arbres polyvalents largement utilisés en Afrique, mais menacés dans leur milieu naturel. Le préféré utilisé a été analysé au moyen d’un indice d’importance culturelle. Les connaissances écologiques locales sur leur conservation ont été étudiées parmi les populations locales vivant autour de la réserve de biosphère de Pendjari au Bénin. Au total, 160 personnes appartenant à quatre groupes ethniques (Gourmantche, Waama, Berba et Peulh) ont été interrogées dans douze villages. Les hommes et les femmes âgés de 20 à 90 ans ont été choisis au hasard dans chaque groupe ethnique. Pour chaque espèce, un indice d’importance culturelle a été calculé en combinant la fréquence et l’importance de l’utilisation. Cet indice nous a permis d’identifier les différences d’intensité d’utilisation au sein et entre les groupes ethniques. Les connaissances écologiques traditionnelles ont été testées en tant que variable dépendante de l’origine ethnique. Les résultats ont montré que la plupart des communautés utilisaient couramment A. africana comme médicament, fourrage et artisanat, tandis que P. erinaceus était la source de fourrage préférée de toutes les populations locales. K. senegalensis a été principalement utilisé comme médicament et bois de chauffage par la plupart des communautés, sauf par les Peuls qui préfèrent l’utiliser comme fourrage. L’utilisation de ces arbres comme source de bois de chauffage était principalement signalée par les femmes, tandis que les hommes âgés de l’ethnie Gourmantche rapportaient leurs utilisations religieuses. L’utilisation médicinale et fourragère d’A. Africana, l’utilisation de fourrage de P. erinaceus et l’utilisation médicinale de K. senegalensis avaient la valeur d’indice d’importance culturelle globale la plus élevée. Les connaissances relatives à l’extinction locale des espèces cibles et à leur utilisation durable variaient selon les groupes socioculturels. Ces résultats ont été utilisés afin de proposer des stratégies de conservation pour une conservation efficace de ces espèces d’arbres.
Le chapitre 4 évalue l’efficacité de la réserve de biosphère de Pendjari pour conserver la composition des espèces d’habitat et la structure de la population de A. Africana Sm., P. erinaceus Poir. et K. senegalensis (Desv.) A. Juss. Les deux questions de recherche suivantes ont été abordées: (i) les habitats protégés de ces espèces d’arbres sont-ils différents de ceux qui ne sont pas protégés dans la composition des espèces? (ii) Les structures de population (exprimées par la densité et la distribution des classes de taille) de ces espèces d’arbres ont-elles été positivement affectées par cette aire protégée? Cent vingt (120) parcelles ont été échantillonnées au hasard dans les habitats protégés et environnants non protégés en inventoriant les espèces végétales. Pour les trois espèces cibles, nous avons mesuré les adultes et les juvéniles, les densités et les classes de taille enregistrées. Selon la composition floristique, quatre groupes d’habitats ont été identifiés en relation avec les perturbations anthropiques, le type de végétation, le statut de protection officiel et l’humidité. Il y avait des savanes protégées, des savanes non protégées, de vieilles jachères et des forêts-galeries. Les densités d’adultes d’A. Africana estimées étaient similaires entre les savanes protégées (13,64 arbres / ha) et non protégées (17,44 arbres / ha), tandis que pour P. erinaceus, la densité des adultes était significativement plus élevée dans les savanes protégées (11,74 arbres / ha) (4,76 arbres / ha). La densité adulte estimée de K. senegalensis était également significativement plus élevée dans les galeries forestières protégées (40,00 arbres / ha) que dans les forêts non protégées (28,89 arbres / ha). Les densités juvéniles de A. africana, K. senegalensis et P. erinaceus étaient plus élevées dans les habitats protégés que dans ceux non protégés, mais la différence n’était pas significative. Dans tous les cas, l’aire protégée était efficace pour entretenir les grands individus. Le coefficient d’asymétrie indiquait que les populations d’arbres étudiés étaient en déclin dans leurs habitats protégés. Cependant, le cas des populations d’A. Africana et de K. senegalensis semblait être un heurtoir dans la zone protégée. Nos résultats suggéreraient que le PBR est efficace pour protéger les habitats de la savane contre la fragmentation et il devrait être nécessaire de définir et d’appliquer des stratégies de gestion pour conserver efficacement A. africana et K. senegalensis dans la zone protégée à l’avenir.Au chapitre 5, nous avons évalué l’efficacité de la réserve de biosphère de Pendjari pour conserver la composition en espèces ligneuses, la diversité et la structure des savanes, le type de végétation le plus répandu dans la zone d’étude. Les résultats ont montré que les deux types de savane présentaient un total de 58 espèces représentant 44 genres et 23 familles avec Combretaceae, Mimosoideae, Caesalpinioideae et Rubiaceae comme familles les plus abondantes par ordre décroissant. Cependant, certaines espèces avaient un indice de valeur d’importance élevé (IVI) dans la savane non protégée, tandis que d’autres présentaient le même schéma dans la savane protégée. Des valeurs plus élevées de la richesse en espèces, de la diversité de Shannon-Wiener et de l’indice de Margalef ont été trouvées dans les savanes protégées comparativement aux espèces non protégées au niveau de la couche d’arbres. Le nombre d’individus et les densités étaient significativement plus élevés dans les savanes protégées que dans les savanes non protégées au niveau des strates arbustives. En ce qui concerne la surface terrière, des valeurs significativement plus élevées ont été trouvées dans la savane protégée par rapport à la zone non protégée aux deux niveaux. Ces conclusions permettent de conclure que l’efficacité de la PBR pour conserver la structure des savanes et la diversité ligneuse dépend de la couche ligneuse. Cependant, la modification de la composition des espèces ligneuses en relation avec l’état de conservation de la savane peut également être évidente selon les espèces à utilisation spécifique d’interrelation. Le chapitre 6 a étudié la structure des peuplements et la distribution spatiale de A. africana comme étant utile pour comprendre son mode de dispersion des graines primaires. La répartition spatiale des arbres adultes et des juvéniles de l’espèce, la relation spatiale entre ces deux stades de développement et la structure du peuplement ont été étudiées dans les savanes dominées par A. africana. Les résultats ont montré qu’A. Africana était présenté dans la distribution aléatoire de la réserve à grande échelle en tenant compte de tous les individus. Cependant, la distribution agrégée a été observée à petite échelle (jusqu’à 9 m) dans certaines zones. Les adultes ont présenté dans toutes les zones une distribution aléatoire, soit à grande et à petite échelle. La distribution spatiale des juvéniles suit la même tendance de répartition de tous les individus regroupés et révèle une distribution agglomérante allant jusqu’à 9 m et une distribution aléatoire à grande échelle. La relation spatiale entre les adultes et les juvéniles n’a pas révélé d’association positive à petite ou à grande échelle. La structure du peuplement a également montré une variation pour certains paramètres structuraux: densité des arbres et surface terrière dans la réserve. Nous suggérons que le mode de dispersion des graines par gravité devrait être le mode de dispersion primaire de la graine chez A. africana.Le chapitre 7 a évalué l’efficacité potentielle du PBR sur la prévention de la prolifération du gui sur les individus du karité. L’infestation par les guis du karité a été évaluée dans deux habitats contrastés: les zones d’utilisation des terres (champs et jachères) et les zones protégées (PBR). Les résultats ont montré qu’environ 80% des arbres de karité sont infestés dans la zone d’utilisation des terres alors que seulement 27,3% des arbres de la PBR étaient infestés. Dans l’ensemble, les arbres de karité fortement infestés avaient des troncs et des hauteurs significativement plus grands, principalement dans les zones d’utilisation des terres. La zone d’utilisation des terres s’est avérée corrélée avec des degrés élevés et très élevés d’infestation par le karité, tandis que les autres degrés d’infestation (très faible, faible et modéré) étaient corrélés aux deux zones. Par conséquent, les arbres de karité qui poussent dans les zones protégées sont mieux protégés contre les parasites des plantes gui que ceux des terres cultivées. Le chapitre 8 traite de la variation de l’impact du gui sur la production de fruits du karité dans des habitats contrastés et de ses implications pour sa conservation. Quarante et un (41) individus de Karité faiblement infectés et 41 fortement infectés, de taille similaire, ont été sélectionnés dans la zone protégée et dans les parcs adjacents. Les caractères du karité tels que le diamètre à hauteur de poitrine, le diamètre de la canopée, la hauteur de la canopée, le nombre de fruits produits, le nombre de souches parasitaires et le rapport d’indice d’impact ont été évalués pour chaque individu. Une ANOVA à deux voies a montré que le gui n’avait pas d’impact significatif sur le rendement des fruits, que ce soit dans les parcs ou dans les zones protégées. Une analyse hiérarchique par grappes avait tendance à regrouper tous les arbres de karité regroupés en fonction des habitats. Une analyse ANOVA à un facteur et une analyse discriminante canonique sur des caractères quantitatifs ont révélé que les groupes de karité étaient significativement discriminés et que de nombreux individus infestés dans les parcs étaient caractérisés par le plus grand nombre de souches infestées (n) et l’indice d’impact. Compte tenu de la corrélation entre les caractères, une variation a été observée entre les deux habitats contrastés. Les résultats ont été utilisés pour mettre en œuvre certains plans de conservation du karité. Le chapitre 9 traite de la discussion générale sur l’efficacité de la protection des obtentions végétales pour conserver la biodiversité. Le PBR s’est avéré relativement efficace dans la conservation de la biodiversité. Cependant, des mesures de gestion doivent être prises pour améliorer la conservation de la biodiversité dans cette réserve de biosphère.